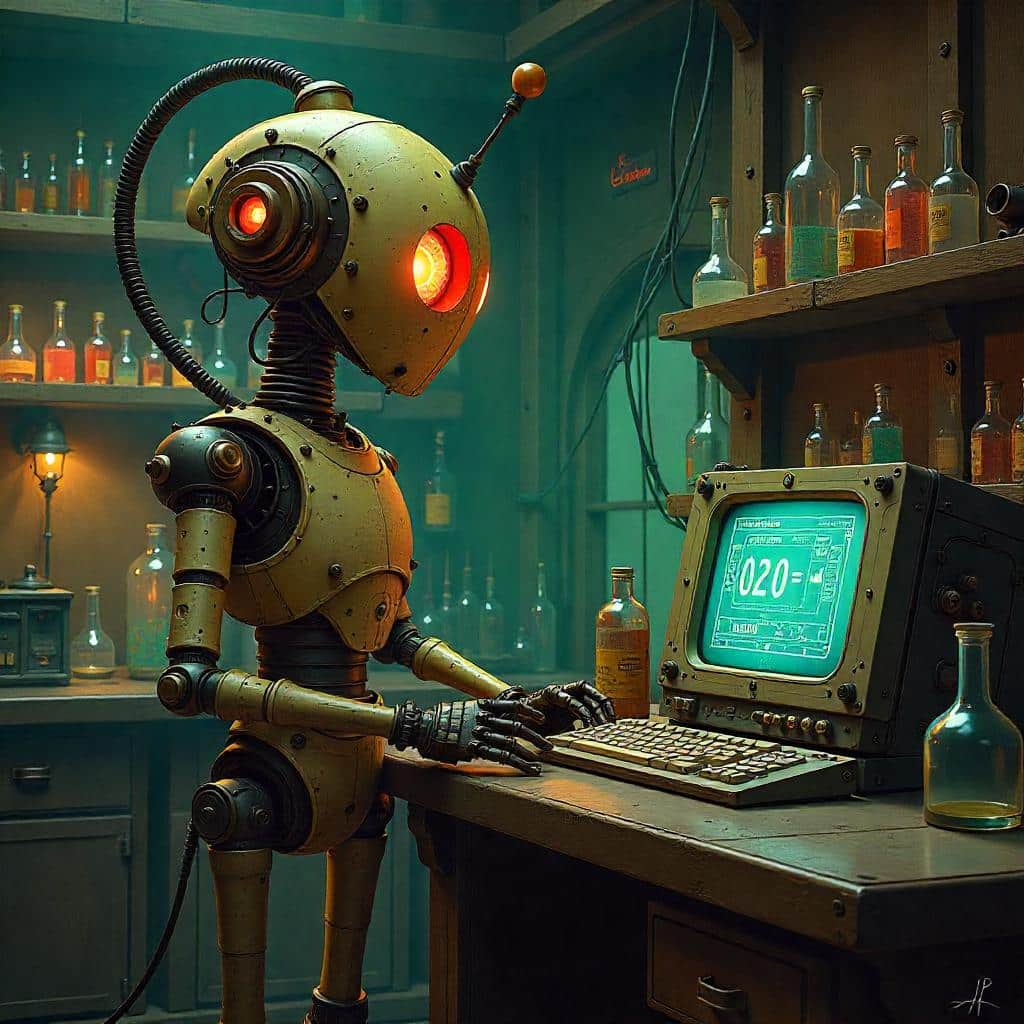Une rupture s’amorce aujourd’hui
Un bouleversement majeur est en cours dans la manière dont nous envisageons les architectures des systèmes d’intelligence artificielle. Pourtant, il semble que l’ampleur et surtout l’impact radical de ce changement sur l’écriture des logiciels ne soient pas encore pleinement perçus.
Je ne parle pas ici des outils de développement basés sur des prompts — ce que certains nomment le « vibe coding » — qui viennent de franchir une étape supplémentaire avec le lancement de Firebase.io par Google. Ce dernier est un outil novateur.
Non, ce dont il est question ici, ce sont les protocoles agent-à-agent (A2A) récemment dévoilés par Google, en complément du protocole Model Context d’Anthropic. L’union de ces technologies ouvre des perspectives incroyables qui, à terme, ne se contenteront pas de transformer nos pratiques en matière de création de logiciels ; elles redéfiniront également les fondements mêmes de nos sociétés.
Depuis quelques mois, une interrogation ne cesse de me tarauder : que se passe-t-il lorsque nous modifions de manière fondamentale la structure qui supporte l’exécution des logiciels ? Car, en réalité, le monde dans lequel nous évoluons est profondément imprégné par les logiciels.
La fin des logiciels déterministes ?
Depuis sept décennies, les logiciels ont toujours été développés selon une méthode rigoureuse et explicite. Instructions claires, connexions précises, logique sans ambiguïté : le déterminisme est le pilier de cette approche.
Chaque interaction doit être codée, chaque flux de données rigoureusement défini, chaque décision parfaitement cartographiée. Ce modèle dit « en cascade » s’est imposé comme la norme. Peu importe les compétences du programmeur ou la richesse du langage employé, une constante demeure : un logiciel ne peut aller au-delà des limites que son créateur lui impose.
Ce cadre est contraignant et frustrant. Il nécessite une planification exhaustive et limite les possibilités, même dans un monde où le Web 2.0 a introduit des interactions humaines inédites. Mais, même ici, les échanges restent confinés dans des cadres prédéfinis, engendrant les fameux « effets de bord ».
Or, à partir d’aujourd’hui, le rythme de cette transformation va s’accélérer — et beaucoup d’ingénieurs n’en ont pas encore pris la mesure.
MCP : Une révolution dans le code
Le protocole MCP marque une véritable rupture. Plutôt que de programmer en détail le comportement d’une IA vis-à-vis des outils, MCP introduit une approche nouvelle : on décrit les capacités des outils de manière structurée, puis on laisse l’IA décider de leur utilisation.
Ce changement, subtil en apparence, est pourtant d’une portée phénoménale. Nous passons de la programmation explicite à une description des capacités. L’interface devient le prompt.
Grâce au MCP, la conception des logiciels évolue. Nous assistons à l’émergence d’agents capables de choisir eux-mêmes la manière d’exploiter des outils existants via ce protocole.
Imaginez un système où vous indiquez simplement le style de musique souhaité : la machine configure automatiquement les synthétiseurs connectés, sans intervention humaine.